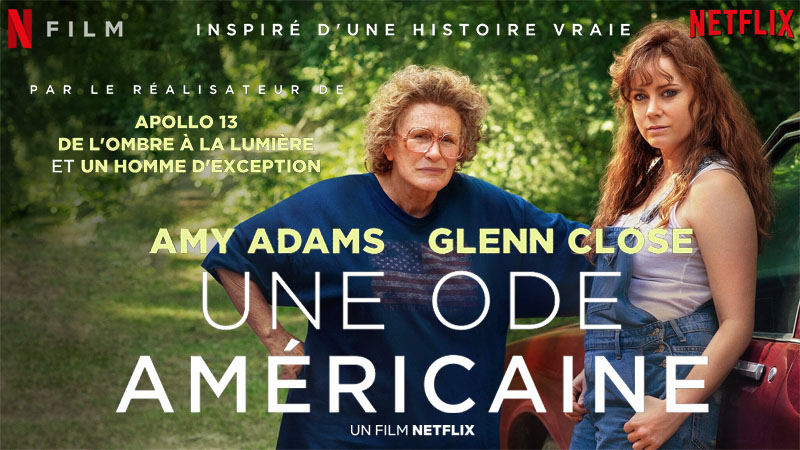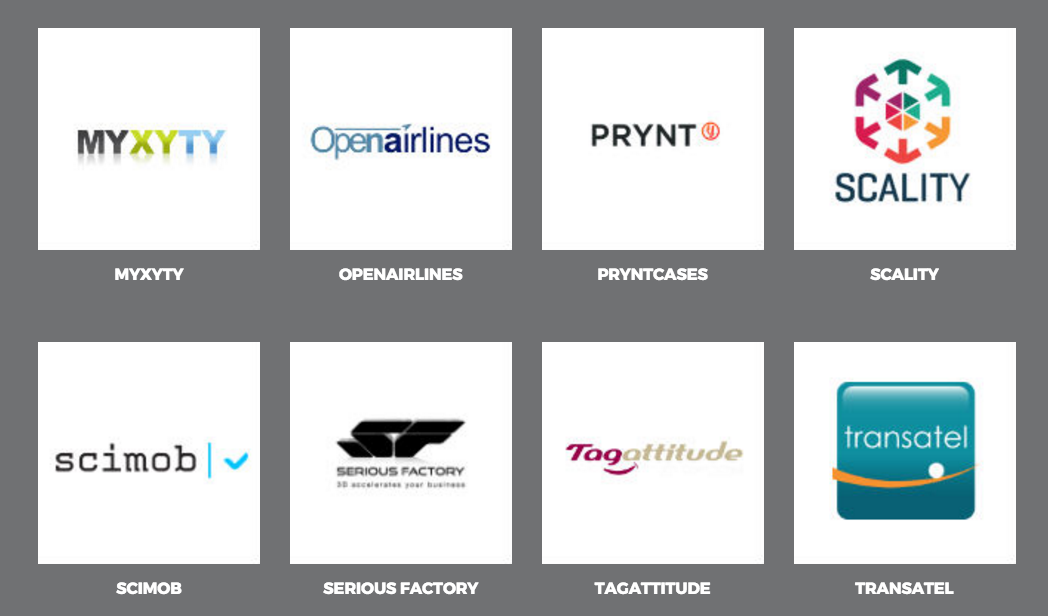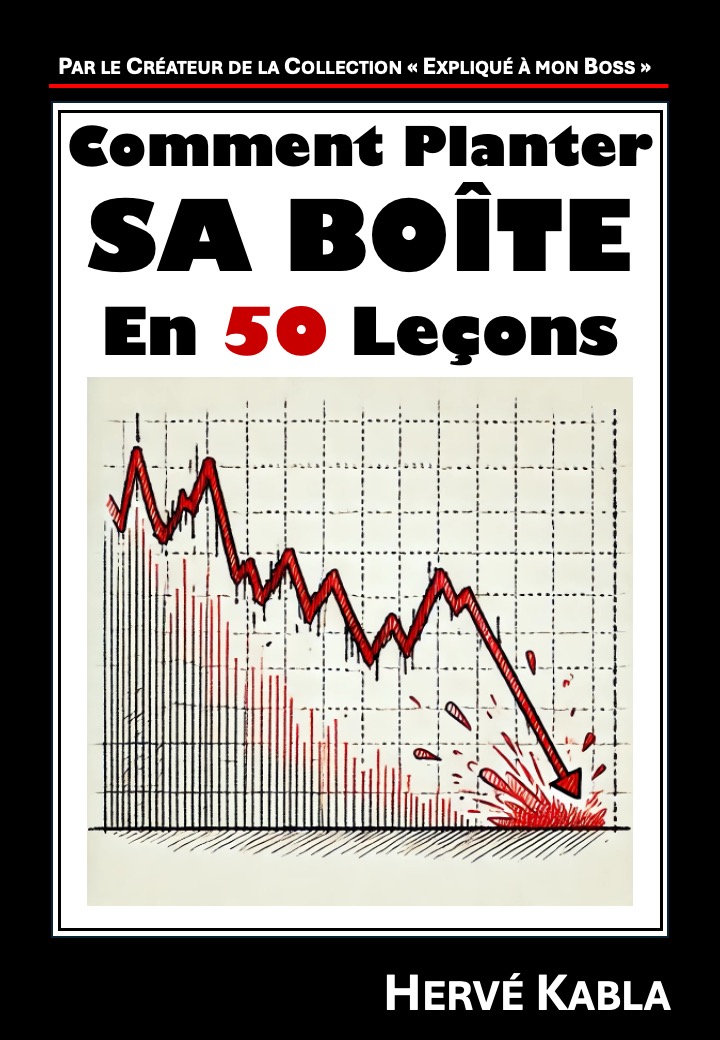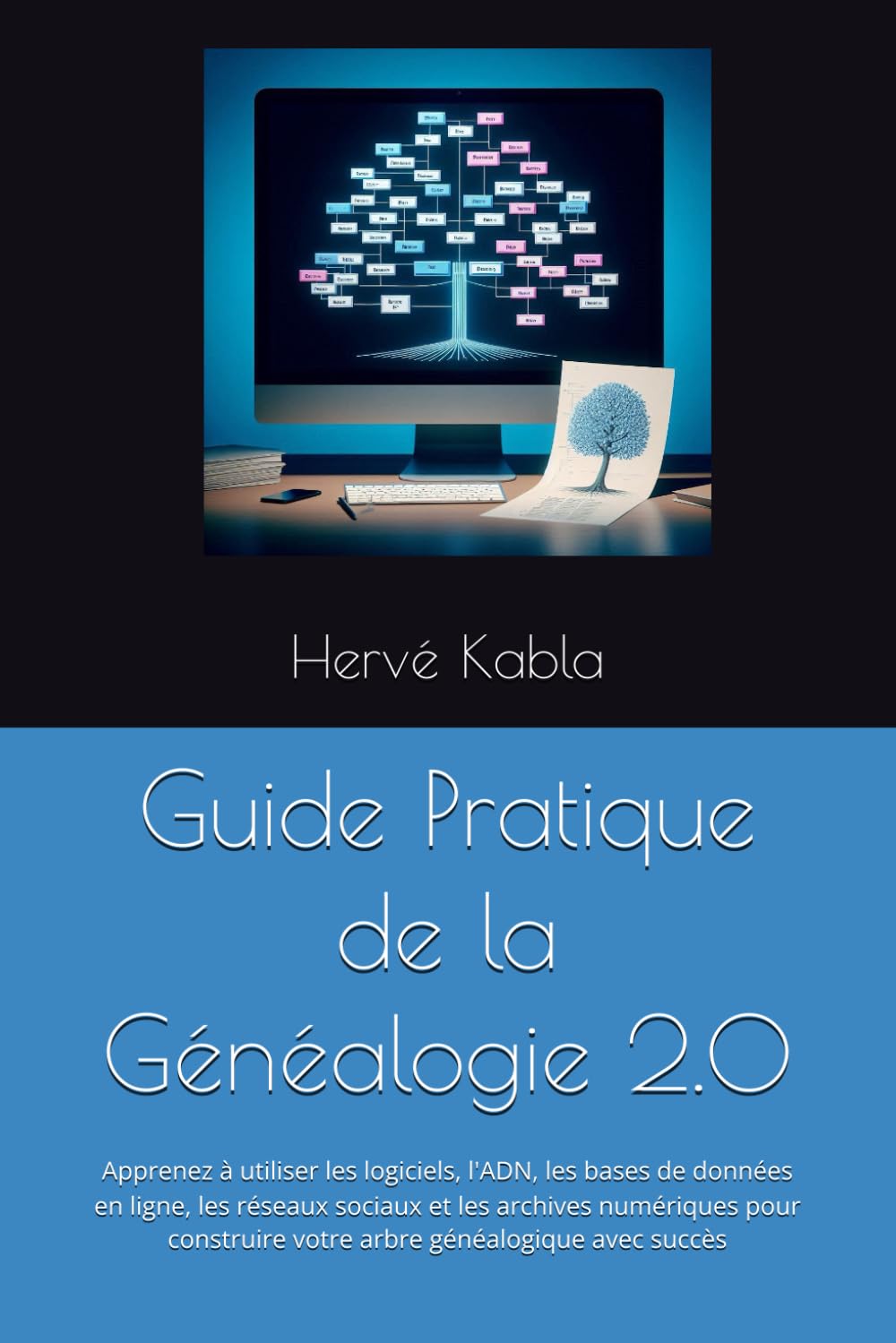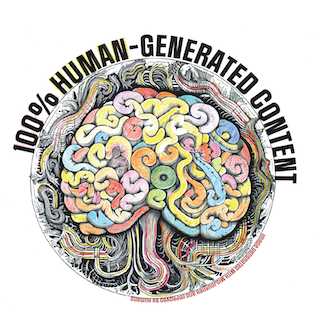La douloureuse transformation digitale du terrorisme international
Les organisations terroristes ont toujours cherché à maximiser l’impact de leurs actions, non seulement par le nombre des victimes de leurs actes, mais également par le nombre de spectateurs, directs ou indirects, de manière à diffuser la stupeur et l’effroi au sein de la population. C’est pourquoi au-delà de la transformation des modes opératoires, on a vu, ces dernières décennies, s’opérer une réelle modernisation des moyens d’actions et de l’usage de la technologie. Les attentats du 11 septembre 2001, la diffusion d’exécutions des otages, et jusqu’à la diffusion en direct des exactions du Hamas le 7 octobre 2023 relèvent de cette volonté de tirer parti des moyens offerts par la technologie, au service de l’horreur.
Pourtant, cette modernisation des actions terroristes semble buter sur un sujet : la communication interne. Oussama Ben Laden l’avait bien compris, en son temps, lui qui vivait caché, sans téléphone mobile, à l’abri des satellites d’observation, et allait même jusqu’à éviter de diffuser l’ADN de ses selles pour ne pas être repéré. Les mouvements terroristes actuels, du Hezbollah au Hamas en passant par les Houthis, sont exposés aux mêmes problématiques liées à la diffusion outrancière des moyens de communication modernes, et on a vu l’an dernier lors de l’opération bipeurs…
Mais quand on menace l’entité sioniste ou une autre partie du monde, les choses n’avancent pas toutes seules, et il faut bien réunir ses sbires de temps à autre, ne serait-ce que pour synchroniser les montres (à l’ancienne) ou choisir son successeur putatif. Alors comment faire ? Se réunir en présentiel pose le risque évident de mettre tous ses oeufs dans le même panier. Se réunir en virtuel, via Zoom, teams ou Google Meet, pose le problème de la géolocalisation, qui fut funeste à plus d’un maître artificier.
Que faire ?
Les trois organisations dont le nom commence par un H citées plus haut ont apparemment opté pour la première solution : réunir les grands manitous dans une seule pièce. Erreur de débutant, aurait-on envie de dire. Et si ces grands méchants avaient un peu de culture cinématographique, ils se seraient souvenus d’une scène éclairante sur les risques encourus…

Le film The naked gun, sorti en 1988 et adapté en français sous le titre Y a-t-il un flic pour sauver la reine, posait déjà, en termes plus crus, le problème de ces rencontres au sommet entre gens peu fréquentables. On y voyait Kadhafi, Castro, Khomeini, Gorbatchev (d’avant la chute du mur), Arafat (d’avant Oslo) et d’autres chefs de nations que l’Amérique qualifiait alors de terroristes, se faire botter le cul par l’excellent Steve Martin.
C’est ce qui s’est de nouveau passé hier, et quelques semaines auparavant.
À plusieurs reprises, Israel a montré sa capacité à localiser de telles réunions physiques, éliminant d’un seul tir une brochette de cadres patentés. Au Yemen, en Syrie ou, comme hier, à Doha, la « frappe chirurgicale » a permis de réduire de manière drastique la durée de la réunion hebdomadaire de ces grands cadre peu précautionneux, et de poser une nouvelle fois, en termes clairs, le problème auquel sont confrontées des milliers d’organisations, pacifiques ou terroristes.
Entre télétravail et présentiel, quel est le bon dosage ?
Je n’ai pas la réponse, et je laisse chaque lecteur tirer ses propres conclusions.
Hervé Kabla, CTO de Cymon, ancien patron d’agence de comm’, consultant très digital et cofondateur de la série des livres expliqués à mon boss.
Crédits photo : Yann Gourvennec